Plus haut grade universitaire, le doctorat est aussi le seul à obliger à la création d’un savoir original. Depuis ses origines religieuses au XIIIe siècle, le doctorat sanctionne la maîtrise du bagage intellectuel nécessaire pour enseigner à l’université ; quelques siècles plus tard il s’accompagne d’une autre exigence, celle de la production de nouvelles connaissances.
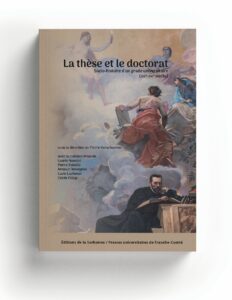
C’est ainsi, à plus ou moins brève échéance, que le changement s’opère dans le monde occidental, où émergent de nouveaux modèles d’enseignement supérieur très centralisés. Cette transformation intervient au tout début du XIXe siècle en France, après que les universités ont pu renaître des cendres révolutionnaires, et en Prusse après les guerres napoléoniennes. Aux États-Unis, les premiers Doctors of philosophy (PhD) apparaissent à Yale en 1861. Le doctorat nouvelle formule, alliant recherche et enseignement, gagne l’Angleterre via Oxford en 1917, puis Cambridge et Londres en 1919, bien avant l’Italie, où le Dottore di ricerca date de 1982.
Après avoir étudié comment les savants se sont transformés en chercheurs1, Pierre Verschueren retrace l’histoire de ce diplôme d’une importance particulière dans La thèse et le doctorat, ouvrage édité en collaboration avec de nombreux contributeurs.
Le livre raconte par exemple comment, dans tous les pays de l’OCDE, le nombre de titulaires de doctorats monte en flèche à partir des années 1990, creusant l’écart avec les postes universitaires disponibles, et s’accompagnant d’un transfert des compétences vers la sphère non académique. Il explique comment la production de thèses dédiées aidera à faire reconnaître la géographie comme une discipline à part entière, avant d’ouvrir l’université au domaine de la création artistique. Il montre la différence de conception entre la thèse-œuvre et la thèse-projet, souligne l’investissement des doctorants d’hier et d’aujourd’hui, leurs difficultés comme leurs satisfactions.
« Depuis deux siècles, ils et elles sont de plus en plus nombreux à s’engager dans l’aventure, à prendre par passion ce risque irraisonnable et à soumettre à l’étude tout ce que l’humain peut chercher à connaître et à comprendre : il y a là une forme indéniable de grandeur », conclut l’auteur.
Pierre Verschueren est enseignant-chercheur en histoire à l’UMLP / Centre Lucien Febvre, et spécialiste de socio-histoire. Parallèlement à la publication de cet ouvrage, il est engagé dans le projet ès lettres, dont l’un des objectifs est de numériser les thèses soutenues en France au XIXe siècle. L’exposition virtuelle Devenir savants : thèses et doctorats ès lettres au XIXe siècle, met en lumière ce travail de recueil, de traitement et de restitution d’information. Elle est accessible sur NuBIS, la bibliothèque numérique de la Sorbonne, pilote de ce projet aux côtés de l’université Marie et Louis Pasteur.