8 mai 1945. La capitulation de l’Allemagne nazie met fin à la Seconde Guerre mondiale sur le terrain européen. Quatre-vingts ans plus tard, alors que se commémore cet anniversaire, la situation de l’Europe, par certains aspects, résonne de manière troublante avec des éléments de ce passé.
La guerre entre la Russie et l’Ukraine est un dramatique retour des hostilités sur le vieux continent, qu’elle fait trembler, le nationalisme gagne du terrain dans plusieurs pays de l’Union européenne, parfois jusqu’au sommet des États, l’antisémitisme enfin, retrouve depuis dix ans une expression qui rappelle les années 1920 et 1930. Dans ce contexte comme dans d’autres, l’histoire est utile pour analyser le présent et mesurer ses enjeux à l’aune du passé.
Celle de la Seconde Guerre mondiale est l’un des domaines de recherche de Marie-Bénédicte Vincent et de Paul Dietschy au Centre Lucien Febvre, qui coordonnent pour l’UMLP un projet portant sur la question du militantisme fasciste dans l’Europe des années 1920 à 19451. « Il s’agit de découvrir et d’analyser des parcours individuels pour comprendre ce que signifiait être au quotidien un militant ou une militante fasciste. » Des études de cas documentées par les archives personnelles de gens ordinaires, de la « micro-histoire » pour appréhender de grandes questions et établir des comparaisons entre les fascismes en Europe d’une manière inédite.

« En Allemagne, l’histoire du parti nazi comporte plusieurs phases, entre sa création en 1920 et sa fin en 1945 », explique Marie-Bénédicte Vincent, historienne spécialiste de l’Allemagne nazie.
« Avant 1933, date de l’arrivée d’Hitler au pouvoir, l’adhésion au parti était essentiellement idéologique. Les recrues de cette période comptent parmi les nazis les plus fervents. » Après le Traité de Versailles de 1919, la révision des frontières, le montant astronomique des réparations exigé, l’occupation de la Rhénanie puis de la Ruhr en 1923, et toutes autres décisions jugées humiliantes par l’Allemagne à l’issue du Diktat sont inacceptables pour beaucoup, et font le lit de la propagande nazie.
Au début des années 1930, la situation économique du pays est catastrophique, un tiers de la population active est au chômage, une conjoncture épouvantable mise sur le compte de la République et aussi des Juifs, favorisant l’antisémitisme. En face d’un parti républicain qui semble inefficace pour gérer la crise, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, apparaît une solution pour les milliers d’Allemands qui rallient sa cause. Ils sont 97 000 adhérents fin 1928, 850 000 au moment de l’accession au pouvoir d’Hitler, le 31 janvier 1933.
Avec la mise en place du régime nazi, les adhésions s’emballent : entre janvier et mai 1933, pas moins d’1,6 million de nouveaux militants rejoignent les rangs du NSDAP. « Ces adhésions-là sont davantage du ressort de l’opportunisme. Elles correspondent à des intérêts familiaux, professionnels ou politiques. » Bien que le NSDAP ait clos les adhésions entre mai 1933 et mai 1937, il reste attractif d’autant qu’il est devenu parti unique en juillet 1933, et nombreux sont ceux qui continuent de postuler. Bon nombre d’Allemands espèrent par son intermédiaire pouvoir trouver du travail ou rester fonctionnaires.
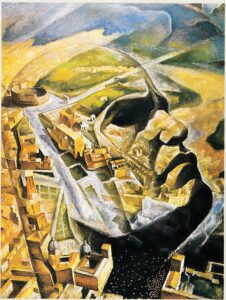
L’Italie fasciste, quant à elle, a dix ans d’avance sur le nazisme. Là aussi, pour expliquer le militantisme, la croyance en une nouvelle « religion politique » le dispute à la recherche de l’intérêt personnel. Le PNF, Parti national fasciste, est ainsi rebaptisé par la population italienne Per necessità familiare, « par nécessité familiale », une formule sans équivoque. « Certains anciens militants fascistes changent d’ailleurs de camp après la chute de Mussolini et la capitulation de l’Italie en septembre 1943, pour épouser la cause des partisans, les résistants italiens s’opposant à l’occupant allemand », précise Paul Dietschy, spécialiste de l’Italie contemporaine et historien du sport.
Du côté des pratiques associées à l’adhésion à un parti, le chercheur étudie justement comment le sport, discipline d’importance pour le fascisme, joue un rôle dans les trajectoires des militants.
« Dans l’Italie de Mussolini, dans la France de Vichy, les organisations sportives sont sous le contrôle de l’État. Le sport continue malgré la guerre. Si en cyclisme, le Tour de France et le Giro d’Italia sont annulés pendant les hostilités, les championnats de foot sont toujours disputés. Le régime de Vichy instaure l’épreuve sportive au baccalauréat, en 1941. Le sport féminin se développe en France, notamment en athlétisme et en basket. Le sport spectacle progresse en Italie. On assiste à une tentative de réorganisation du sport international sous l’égide du Troisième Reich. » Dans un tel contexte, fascisme et sport se confondent parfois, comme le montre le témoignage d’un chef de la formation partisane italienne Giustizia e Libertà, Nuto Revelli : « Pour l’adolescent qu’il était avant la Seconde Guerre mondiale, « le fascisme et le sport étaient la même chose » ; il était « orgueilleux de ses rubans et de ses médailles » remportés lors des compétitions encadrées par la GIL, l’organisation fasciste de la jeunesse réformée en 1937 », rapporte Paul Dietschy.
Retracer les trajectoires des militants par le biais des archives apporte de nouveaux éclairages sur ce que fut leur engagement dans l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, sur la réalité quotidienne et les impacts de leur adhésion. L’histoire vue à l’échelle de l’individu pourra aussi mieux faire connaître le militantisme fasciste prévalant à la même époque dans d’autres pays d’Europe, que représentent par exemple les Oustachis en Croatie, les Croix fléchées en Hongrie, la Garde de Fer en Roumanie, ou encore le mouvement Rex en Belgique.