Les preuves s’accumulent et les consciences s’éveillent pour considérer que l’être humain fait partie intégrante de la nature, qu’il en est un composant, tout comme le sont les arbres, les plantes, les autres mammifères, les champignons ou les acariens. Des relations et des interactions biologiques, chimiques et génétiques se tissent au sein d’une même espèce et entre les espèces, elles sont au cœur de l’évolution de la Vie sur Terre.
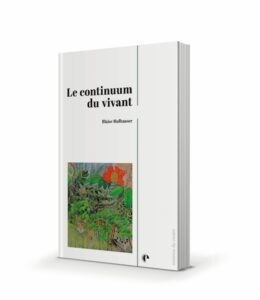
Cette hypothèse d’une « évolution incessante et interdépendante à tous les organismes » est celle que formule Blaise Mulhauser, et qu’il développe de manière passionnante dans son ouvrage Le continuum du vivant.
Blaise Mulhauser est biologiste et écologue, et directeur du Jardin botanique de Neuchâtel.
Il propose dans cet essai d’ouvrir la biologie et ses différents champs d’analyse à ce qu’il nomme la « symbiologie » : c’est l’étude du vivant élargie à ses fonctionnements secrets, invisibles, mais bien réels, une approche comparable à celle de la mécanique quantique dans le domaine de la physique.
L’auteur met en évidence cette optique nouvelle, parfois dérangeante comme tout ce qui fait progresser les connaissances établies, en la nourrissant d’exemples scientifiques et de réflexions d’ordre philosophique.
« Pour comprendre l’évolution de la Vie, il faut se souvenir que les bactéries ont réussi à mettre au point la photosynthèse, un processus majeur qui permet de transformer la lumière en une source d’énergie utilisable par l’organisme. » Et que l’oxygène s’est placé au centre des processus biologiques régissant le monde vivant il y a huit cents millions d’années, après que son taux a remonté dans l’atmosphère à la fin de glaciations intenses. Ou encore que l’apparition des abeilles date de cent millions d’années, comme celle des plantes à fleurs, ce qui n’est pas une coïncidence.
Autant d’évolutions lentes et mises en place sous l’action de micro-organismes à la capacité d’adaptation et à la vitesse de reproduction incroyables.
L’« intention » de ces microbes, virus et bactéries, comme celle de tous les êtres vivants avec lesquels ils évoluent et qu’ils font évoluer, est de se préserver de variations environnementales potentiellement menaçantes pour leur survie. Ce processus symbiotique entre espèces peut parfois se montrer défaillant, expliquant le parasitisme et les épidémies, et que de tels phénomènes puissent toucher certaines espèces et pas d’autres.

L’auteur met l’accent sur la frontière parfois ténue entre parasitisme et effets bénéfiques des micro-organismes, et explique qu’on pourrait gagner à les considérer différemment.
« Notre conception des microbes et des virus, et au-delà, toute notre approche du vivant, est biaisée dès l’instant où, portée par l’espoir de se guérir de maux terribles, l’humanité a concentré ses efforts dans son combat contre les causes de la mort. »
Le biologiste s’intéresse à la notion de microbiote, arguant que notre système digestif n’est pas notre second cerveau comme on l’entend souvent, « mais qu’il en est l’origine ». Il montre comment la composition de la flore intestinale influence des comportements observés chez le rat ou l’araignée, comment cette dernière réalise des toiles de formes et de résistance aussi différentes que les substances qu’on lui fait ingérer.
La caféine par exemple lui fait produire des géométries invraisemblables et inutilisables. L’auteur souligne que ce résultat n’est pas si étonnant, si l’on considère que la caféine est une substance active produite par le caféier pour se protéger des attaques d’insectes ravageurs qui sont des arthropodes, comme le sont les araignées…
La notion de comportement renvoie à celle de conscience, auxquelles, comme celle d’intention, il convient de donner une acception bien plus large que celles qui sont caractéristiques de l’être humain. On le sait aujourd’hui, les animaux, les végétaux, les champignons et les bactéries réalisent des alliances et « communiquent » entre eux, des échanges basés sur une « conscience chimique » ou « organique ».
« Il ne faudrait pas chercher un type de « conscience humaine » chez la laitue », relève le biologiste avec humour, qui suggère cependant sérieusement que « chaque espèce devrait pouvoir être caractérisée par un certain type de conscience, tout comme il en va de la caractérisation morphologique de ses organes », soulignant à cet égard la différence entre le bras de l’homo sapiens et l’aile du colibri.
Blaise Mulhauser met en lien son hypothèse avec la réalité du bouleversement climatique ou de la récente épidémie de Covid-19 dans ce livre aussi surprenant que fascinant, dont ces mots pourraient constituer, non pas une conclusion, mais une invitation pour notre réflexion d’être humain : « Gardons à l’esprit les liens indéfectibles qui unissent tous les êtres vivants et prenons conscience qu’ils sont l’aboutissement de la longue et passionnante évolution d’un tout dont nous ne sommes que l’expression particulière. »